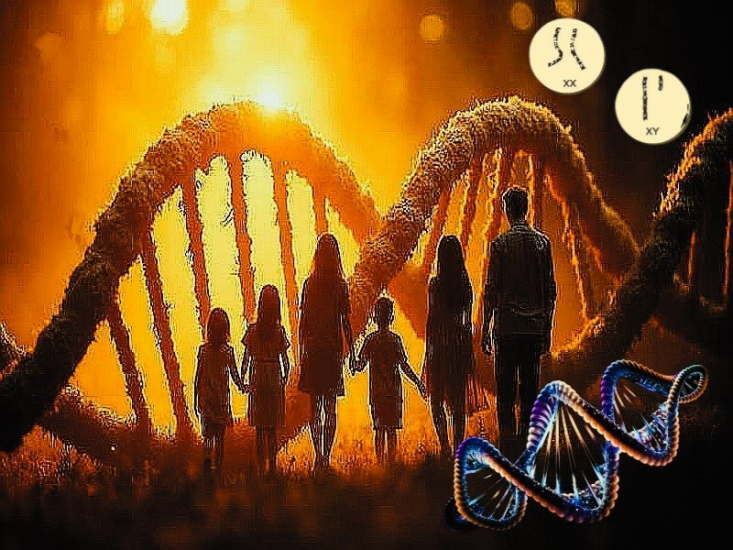Qu’elle évoque le prétendu réchauffement climatique ou le concept de sexes interchangeables, la doxa est anti-scientifique. Elle s’appuie sur des croyances quand les faits démontrent le contraire. Et elle essaie d’imposer son idéologie par la propagande, des menaces et des sanctions.
Mais la science a la peau dure. Galilée a abjuré après le supplice de Giordano Bruno, ça n’a pas empêché la terre de continuer à tourner. Les adversaires de Lyssenko ont fini au goulag mais ça n’a mis fin aux famines en URSS.
La phrénologie n’a pas trouvé la bosse des maths. Pas plus que la physiognomonie n’a réussi à relier le look aux profondeurs de la psyché. Quant à l’anthropologie nazie, elle n’a pas prouvé que les Boches étaient la race supérieure, mais que les hitlériens étaient de sinistres crétins.
Filles et garçons, les corrélations organiques comme les chromosomes posent les premiers jalons
On ne peut pas plus changer le squelette que le génome. Les genristes auront beau prétendre que le masculin et le féminin relèvent des stéréotypes culturels liés à l’éducation et à la perception qu’en a la société, l’appareil uro-génital n’est pas un accessoire, et le dimorphisme sexuel est une réalité implacable. Et cette réalité biologique concerne chacun des éléments du corps humain.
À tel point qu’avant la maîtrise des analyses ADN, quand on trouvait un squelette épars (dont il manquait des morceaux) on déterminait le sexe du défunt par la loi des corrélations organiques. Les os des hommes sont en général plus épais, plus lourds, et les ratios des os longs, bras-avant bras, cuisse-jambe, les articulations, ne sont pas les mêmes selon le sexe de naissance. Pour faire simple, c’est une différence comparable à celle des zébus par rapport aux gazelles.
Parmi les autres éléments significatifs du dimorphisme: le diamètre biacromial (largeur des épaules), le diamètre de l’excavation pelvienne et plus généralement la largeur des hanches. Et le ratio hanches/épaules. La taille et la musculature avantagent les hommes dont les épaules sont plus larges que le bassin, quand chez les femmes c’est inverse.
La forme du crâne est révélatrice et aucun maquillage, aucune perruque, ne permet de tricher quand on sait quoi regarder
S’il peut y avoir des exceptions, chez les Européens d’origine, le standard est le dolichocéphale caucasien. Parmi les traits les plus visibles, les premiers éléments à trahir les travestis malgré tous les grimages sont les orbites oculaires plus carrées dans un crâne masculin. De même que la mâchoire des hommes est plus marquée et proéminente au menton.
En outre, les zones et les bosses crâniennes n’ont pas les mêmes formes et sont réparties différemment. Si tous les crânes ont 22 os, les masculins présentent des spécificités. Les différences concernent les arcs superciliaires proéminents, la glabelle convexe, l’éversion de l’angle de la mandibule, l’apophyse mastoïde de l’os temporal, et en général tous les os avec des marques musculaires plus nettes chez les hommes. Là où la chirurgie esthétique faciale atteint ses limites.
Chez les femmes de naissance, les surfaces sont plus lisses, les éminences frontales et pariétales plus grandes en proportion que celles des hommes avec un front qui tend vers la verticalité, des orbites plus arrondies et une voûte crânienne plus plate.
Au-delà des phénotypes, l’invisible est encore plus différencié. Ainsi, outre les chromosomes XX et XY, le mode d’expression génique varie de façon notable entre les femmes et les hommes. À ce jour, les chercheurs ont identifié des variations de 6.500 gènes exprimées de façon différente, au masculin comme au féminin, dans n’importe quelle partie du corps. Et cela a des répercussions tant sur les maladies génétiques que sur les pathologies à microbes et à virus.
FILLES ET GARÇONS: DES CERVEAUX DIFFERENTS DES LA NAISSANCE
Dès les premiers jours de la vie, les cerveaux des filles et des garçons se singularisent. Une étude récente menée par l’Université de Cambridge, Developing Human Connectome project, a confirmé que des différences, attribuées à l’environnement ou à l’éducation, avaient des origines biologiques originelles trop précoces pour qu’on puisse les attribuer à l’épigénétique.
Des chercheurs, généticiens, biologistes, médecins, anthropologues ont analysé à l’IRM les cerveaux de 500 nouveau-nés. Ils ont confirmé que les garçons avaient en moyenne un volume cérébral plus important que celui des filles, mais que celles-ci présentaient un "câblage" plus serré.
Les filles disposaient de davantage de matière grise, tandis que les garçons avaient plus de matière blanche. Des différences présentes à la naissance.
La matière grise est essentielle pour des fonctions telles que la mémoire, la cognition et la régulation émotionnelle. La matière blanche, facilite la communication entre les différentes régions du cerveau favorisant les capacités de traitement sensoriel et moteur. Les différences observées entre les sexes dans la proportion de ces tissus pourraient expliquer certaines variations dans les capacités cognitives et comportementales, les filles seraient plus douées pour l’analyse, les garçons pour la synthèse.
Mais on reste dans le domaine des tendances, car rien n’est définitif. L’équilibre entre la matière grise et la matière blanche évolue tout au long de la vie. Si chez les nouveau-nés, la matière grise est plus abondante, nécessaire pour une phase d’intense apprentissage, avec l’âge, la matière blanche se développe, permettant des connections plus efficaces entre les régions cérébrales. Ces découvertes questionnent sur le rôle de facteurs prénataux, tels que les hormones ou le développement du placenta, dans la formation de ces différences.
LA DIVERSITE SE RETROUVE AUSSI DANS LES NEURONES
L’université de Cambridge a commencé à dresser une carte des différences absolues dans les volumes cérébraux selon les sexes dans le but de mieux comprendre les variations de la neurodiversité.
Il ne s’agit pas d’établir une hiérarchie entre les sexes (on laisse ça aux talibans) mais de connaître la diversité naturelle du cerveau humain. En explorant les mécanismes biologiques qui produisent ces différences, les chercheurs formulent l’hypothèse que les différences cérébrales observées dès la naissance pourraient s’expliquer par des facteurs biologiques prénataux tels que la testostérone et les œstrogènes, qui influencent le développement du cerveau in utero, en agissant sur une formation différenciée des neurones et des connexions cérébrales.
La neurodiversité étudie les facteurs à la base des variations naturelles dans le fonctionnement et la structure du cerveau humain. Elle considère que les différences neurologiques observées entre les sexes sont de même nature, que l’expression des talents artistiques ou le génie d’un Léonard ou d’un Enstein. Observables mais inquantifiables avec nos moyens d’investigation actuels. Tandis que les moutons de Panurge politiquement corrects valorisent chez une Greta ou un Jack l’éventreur des expressions de l’immense richesse de la diversité humaine. Là où les gens sensés voient des défauts de fabrication.
De nos jours, toute étude scientifique est récupérée et viciée par les maniaques de la pensée inclusive. D’autant plus persuasifs que leurs contradicteurs sont interdits dans les médias de grand chemin. Alors, certes, il est souhaitable d’adapter aux inadaptés les environnements éducatifs, professionnels et sociaux par souci d’humanité. Et pour essayer d’intégrer les personnes dont les cerveaux fonctionnent différemment.
Mais on dépasse le stade de la compassion louable quand on exige que toutes les formes de pensée soient accueillies et traitées sur un mode égalitaire, les actifs comme les parasites, les inventifs comme les assistés, les altruistes comme les criminels, les simples d’esprit comme les plus performants.
Non pour faire le bonheur des déshérités de la nature.
Mais parce qu’une société avec beaucoup de crétins est la meilleure garantie de conserver le pouvoir pour les crapules qui nous gouvernent.
Christian Navis
https://climatorealist.blogspot.com/