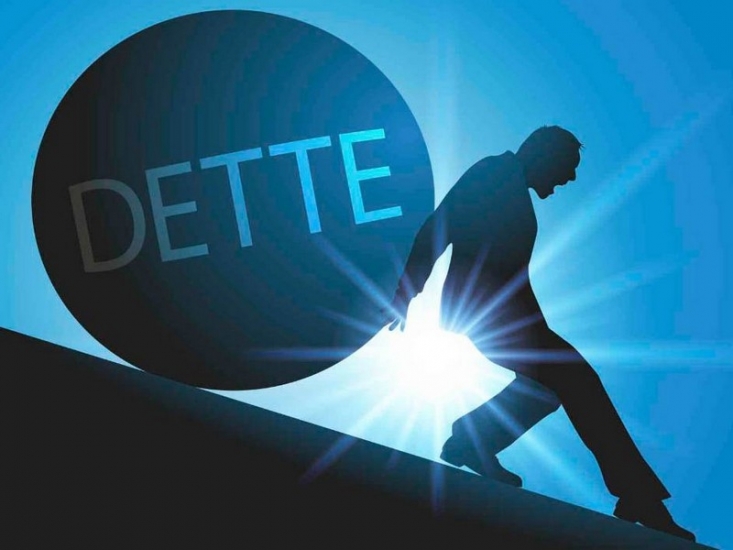"Un pays qui emprunte à l’étranger renonce à une partie de sa liberté. La dette, c’est comme une chaîne: plus elle est lourde, moins vous pouvez bouger". Charles de Gaulle (1965)
Les rapports entre les relations financières et diplomatiques ont fait l’objet de nombreuses études historiques. Mais curieusement, les études académiques sont quasi inexistantes en ce qui concerne l’impact géopolitique de de la détention de la dette souveraine française, alors même que les indicateurs financiers de notre pays se détériorer de manière continue, notamment ces 8 dernières années, ce que traduit la dégradation régulière de la note de la France par les agences de notation. Au 1er trimestre 2025, la dette de l’État détenue par des créanciers étrangers représentait 55% d’ une dette totale de l’État de 3 368,5 Mds d’euros soit 114% du PIB.
Cette absence peut s’expliquer par l’opacité des données sur l’identité des détenteurs étrangers de cette dette, pourtant exceptionnellement élevée au regard des autres pays. Cette opacité des données contraint à formuler des hypothèses qui méritent d’être recoupées. Mais cela n’interdit pas de proposer des réajustements de nature à restaurer la souveraineté financière de la France.
1- La part de la dette de l’État détenue par des créanciers étrangers est particulièrement élevée en France
La structure de la dette de l’État français vis-à-vis de l’étranger est un sujet opaque: les sources officielles sont rares et incomplètes.
La commission des finances et de l’économie de l’Assemblée nationale a rendu le 29 mai 2024 un rapport d’information sur la détention de la dette de l’État par des résidents étrangers. Bien qu’elle se soit heurtée à la mauvaise volonté des services du ministère des Finances et à l’arrogance du ministre délégué macronien Thomas Cazenave, il est possible d’en tirer des conclusions utiles. La question de la dette détenue par des non-résidents avait aussi été évoquée dans le rapport d’information du Sénat relatif à la dette publique du 23 juin 2020. Ces informations peuvent être complétées grâce à deux notes de l’IFRAP de novembre 2023 et juin 2024.
Tout d’abord il convient de souligner la difficulté d’obtenir des éléments précis sur l’identité des détenteurs de la dette publique, l’État ne disposant pas d’une base de données les recensant. En effet, si les personnes morales de droit privée se voient reconnaître la possibilité de connaître l’identité de leurs créanciers obligataires, les personnes publiques, dont l’État, en sont privées. Et il en va de même dans les autres pays de l’UE.
Les chiffres relatifs aux détenteurs de la dette de l’État ne peuvent donc être connus qu’indirectement via les enquêtes de la Banque de France et du FMI, sachant que certains pays du Golfe, dont le Qatar, refusent de communiquer les données.
Nonobstant ces incertitudes, l’administration a accepté de fournir des éléments sur la répartition de la dette de l’État français: en 2024, 53% de celle-ci était détenue par des étrangers et cette proportion a cru considérablement depuis la création de la zone euro (28% en 1999).
Par ailleurs, la dette des non-résidents de la zone euro représentait 23% du total de la dette.
Globalement la France est l’un des pays de l’OCDE dont la dette de l’État est la plus fortement détenue par des non-résidents: elle n’est dépassée que par 4 pays: Finlande, Belgique, Norvège et Autriche.
À l’inverse, d’autres pays parviennent à financer leur dette publique par l’épargne interne tel le Japon (moins de 20% de la dette est détenue à l’étranger), les États-Unis (23%) ou l’Italie qui grâce à sa bonne gestion est parvenue à faire baisser le taux de son exposition aux créanciers étrangers de 40 à 30%.
2- Les risques de perte de souveraineté sont importants
Le rapporteur du rapport d’information du Sénat, Laurent Saint-Martin, alors député macronien, définissait la problématique des rapports entre souveraineté et endettement extérieur en ces termes: " Si l’on définit la souveraineté d’un État comme une situation d’insoumission aux États étrangers, l’endettement est aussi une perte de souveraineté si une part importante des créanciers sont des agents non-résidents".
Même si les investisseurs sont d’abord mus par des préoccupations financières, ils ont une vision globale de leurs actifs et les politiques suivis pat les États débiteurs ont un impact sur la rentabilité de ceux-ci.
Mais surtout, dans le cas d’une situation d’insolvabilité, la restructuration de la dette d’un État ou son rééchelonnement peut conduire à des sanctions ou des mesures de rétorsion de la part des États dont certains des créanciers de l’État emprunteur sont des ressortissants. Le défaut de paiement d’un État affaiblit incontestablement sa position diplomatique. Le recours aux prêts des institutions internationales s’accompagne en général de conditions qui contraignent en outre la souveraineté des États membres.
Les exemples des récentes crises argentine et grecque sont l’illustration de ce risque.
Les diagrammes suivants récapitulent la répartition de la dette des créanciers étrangers par nationalités en 2024 tel que communiqué par le ministère des Finances. Ces chiffres restent approximatifs et partiels compte tenu des défaillances de l’appareil statistique de l’État. On est donc conduit à faire des conjectures qui restent à confirmer.
ON PEUT REGROUPER CES CREANCIERS LES PLUS IMPORTANTS EN 4 CATEGORIES:
– L’Allemagne: 14% de la dette détenue par l’étranger; compte tenu de la mainmise de ce pays sur les institutions de l’UE et de la situation catastrophique des finances publiques et de la balance commerciale de la France, cette dépendance crée un déséquilibre supplémentaire dans nos négociations, notamment au sein de l’UE.
– Les pays anglo-saxons (EU, RU) et leurs satellites directs, en général des "paradis fiscaux" (Irlande, Îles Caïman); on peut penser que ces créances appartiennent principalement aux acteurs privés, dont les fonds de pension: au total 24%. La proximité du régime Macron, comme celle du chancelier Merz avec ces institutions qui détiennent des portefeuilles importants d’actifs dans les industries d’armements et peuvent avoir intérêt à la montée des tensions internationales qui dopent les dépenses militaires, pourraient expliquer l’agressivité de la diplomatie macroniene vis-à-vis de la Russie.
– les autres "paradis fiscaux", tels que les Pays-Bas (6%) et le Luxembourg (16%), auxquels il faut ajouter deux catégories: les "autres" (11%) dont la nationalité n’est pas détaillée et les Réserves (16%) qui regroupent les créanciers dont la banque de France et le FMI ne connaissent pas la nationalité.
Cette "boite noire" représente 49% de la dette des non-résidents. C’est dans ce groupe là que l’on pourrait identifier les principaux risques. On notera en effet que les pays du Golfe, dont on peut pourtant penser, malgré le peu transparence dont ils font preuve, qu’ils sont parmi les plus gros détenteurs d’investissement à l’étranger, n’apparaissent pas dans ces statistiques, ce qui paraît peu vraisemblable.
Ils sont pourtant présents dans les secteurs privés: le stock des investissements qatariens en France est ainsi estimé par l’hebdomadaire Marianne à 50 milliards d’euros et des sources journalistiques fixent pour la dette souveraine française détenue par le Qatar une fourchette de 10 à 15 milliards d’euros. Or l’objectif affiché de l’Émirat est, outre la rentabilité de ses investissements, de renforcer les partenariats stratégiques avec les pays destinataires. Quand on connaît les liens d’une partie de la classe dirigeante française avec ce pays depuis au moins 2005, on peut penser qu‘il y a un rapport avec les outrances anti-israéliennes du régime Macron ainsi qu’avec sa faible implication dans la lutte contre les mouvements islamistes et antisémites.
3- Les solutions existent mais demandent une véritable volonté politique
Deux mesures peuvent améliorer la gestion de la dette publique détenue par les non-résidents.
Le premier objectif est d’améliorer la connaissance de la nationalité des détenteurs de la dette publique par les étrangers en autorisant l’État à exiger l’identification de ses créanciers. Le rapport d’information du Sénat préconisait sans précisions de "mieux connaître les détenteurs de la dette française". Comme le soulignait le ministre cette mesure aurait certainement un effet négatif sur l’attractivité de la dette française. Mais la France a-t-elle intérêt à se trouver liée et à verser des intérêts à des créanciers dont le souhait de garder l’anonymat peut faire douter de leur probité ou de la nature de leurs intentions? La réponse est certainement négative.
Dans ce contexte, la France devrait promouvoir l’établissement de règles permettant l’identification des détenteurs de la dette dans le cadre de l’Union européenne et même si possible au niveau de l’OCDE, les États-Unis étant confrontés à la même problématique. Ainsi, notre pays n’agirait pas seul ce qui lui permettrait d’éviter une dégradation de l’attractivité de ses titres par les investisseurs désirant cacher leur identité. C’est la solution qu’à notamment choisie le Japon.
Enfin, l’adoption de telles règles pourrait être facilitée en acceptant que l’identité des créanciers reste secrète et que leurs noms ne soient en aucun cas publiés, seuls les agrégats relatifs à leur nationalité étant utiles au débat.
Le second objectif est de réduire la part de la dette détenue par les non-résidents au profit des épargnants français. Outre le fait de protéger la France des risques d’interférence étrangère, ce choix aurait l’avantage de reverser aux épargnants nationaux une partie des intérêts, qui représentent au total 55 milliards d’euros en 2024 selon la Banque de France, financés par leurs impôts et actuellement versée à des investisseurs étrangers. L’idée serait de créer un produit d’épargne dédié au financement de la dette publique et accessible aux épargnants français ou citoyens de l’UE, comme cela existe en Italie et au Japon. À cet objectif le ministre opposait, devant la commission des finances, deux arguments, dont l’un est savoureux puisqu’il exprime la crainte qu’en cas de défaut de la France serait renforcé le lien entre risque souverain et risque bancaire, ce qui montre le peu de confiance qu’il porte à la gestion des finances publiques. L’autre argument était de soutenir que la mise en concurrence des investisseurs internationaux permet de baisser le coût de la dette. Outre le fait que cet argument fait peu de cas du souci d’indépendance nationale, il se heurte à la réalité puisque le Japon et maintenant l’Italie se financent à des taux inférieurs à ceux de la France et que la note de la France n’a cessé de se dégrader au cours des dernières années.
Plus généralement, la position du ministre méconnaît le fait que plusieurs pays, autres que l’Italie, comme le Japon, la Suisse ou les États-Unis, financent leur dette en faisant appel en priorité à l’épargne de leurs concitoyens.
Jean Lamolie